
Culture des arts martiaux japonais : interview de Jacques Tapol
Dosukoi vous présente aujourd’hui une interview exceptionnelle d’un grand champion français de Karaté, Jacques Tapol.
Quel est le lien avec le sumô, me direz-vous ?
Tout d’abord, Jacques Tapol a été un grand compétiteur, champion de France, d’Europe et du Monde, et à ce titre, il a une expérience à partager qui s’apparente aux combats des grands rikishi.
D’autre part, c’est un passionné de la culture des arts martiaux japonais, et il est à même de nous l’expliquer pour que nous puissions entrevoir les impacts de cette culture dans le monde du sumô.
Une fois de plus, c’est Jean-Philippe Cabral a mené l’interview de main de maître !

______________________________________________________________
Interview de Jacques Tapol par Jean-Philippe Cabral – Octobre 2019
Jean-Philippe Cabral : Comment êtes-vous venu aux arts martiaux ?
Jacques Tapol : Je suis venu aux arts martiaux parce qu’il y avait l’équipe de France qui préparait les championnats du monde de 1972. Ça semblait mystérieux et étrange. Les karatékas ne faisaient pas de gestes que nous connaissions, et il commençait à y avoir tous les films de « Kung Fu » qui déferlaient et notamment ceux de Bruce Lee.
J’avais besoin de trouver quelque chose qui me permette de me battre, car j’avais été dans un collège en Province et, comme Parisien, les mecs m’avaient pris en grippe. Je me suis fait tabasser pendant un mois ou deux, ils voulaient que je sois leur souffre-douleur. J’étais plutôt chétif et fluet, j’étais pétrifié par ce qui m’arrivait. Soit je continuais à subir, soit je me rebellais ; donc après quelques temps je suis sorti de cette terreur, et j’ai décidé de prendre le plus fort du groupe qui me harcelait et me tabassait. Je me suis battu avec lui dans un bus, je voulais lui crever l’œil. Ensuite il a cessé de m’embêter ainsi que tous les autres, car ils ont senti que j’étais déterminé et prêt à tout. Moi qui étais rêveur, j’avais découvert les ressources pour ne pas subir, mais le problème c’est que j’étais devenu violent. J’étais prêt à n’importe quoi quand je me sentais agressé, et j’étais hyper susceptible.
Quand je suis revenu à Paris, je cherchais quoi faire pour devenir encore plus fort. Lorsque j’ai vu ce reportage (sur l’équipe de France de karaté), j’ai cherché un club de karaté et j’ai commencé chez maître Hiroo Mochizuki, dont le club était juste à côté de chez moi. J’étais impressionné par les ceintures noires, et j’étais un peu intimidé et à l’époque les cours étaient durs et il ne fallait pas se plaindre. Plaindre n’était pas acceptable, car on ne doit jamais montrer de faiblesse sinon l’adversaire en profite.
C’était très japonais et martial.
Je n’ai pratiquement jamais manqué un entraînement en 6 ans avec Hiroo Mochizuki, que je sois blessé ou malade. Un jour je me suis tranché la paume de la main juste avant l’entraînement, mais j’ai fait tous les entraînements du soir, et c’est seulement quand je suis rentré que mon père m’a emmené aux urgences.
Je ne manquais jamais.
Peu à peu je suis monté en puissance car je m’entraînais comme un forcené. Mais j’étais trop brutal et j’étais toujours à la limite. J’ai fait de la compétition mais ce qui m’intéressait, c’était de me battre. La compétition, c’était juste un outil pour s’entraîner.
Jean-Philippe Cabral : Vous avez un palmarès incroyable comme karatéka, pouvez-vous nous en dire plus ?
Jacques Tapol : J’ai eu un très beau palmarès mais si j’avais été plus calme et surtout motivé par la compétition, il aurait sûrement été meilleur. En réalité, je ne comprenais rien à la compétition. Ces combats étaient une façon de m’entraîner à la vitesse et au coup d’œil ; je ne trouvais pas ça vraiment martial. Je ne m’entraînais pas vraiment à la compétition, vu que je m’entraînais comme un forcené d’après ce que j’imaginais avoir besoin en combat réel. Je ne m’entraînais que d’après la notion de KO, et je passais des heures à faire du ciblage pour mettre KO mes adversaires en frappant le plus fort possible.
En compétition, je me faisais souvent battre par disqualification. Pendant 5 ans, j’étais disqualifié à toutes les compétitions. Bien sûr, il m’arrivait de perdre parce que je tombais aussi sur des adversaires meilleurs que moi. Mais je n’avais peur de personne. J’étais aussi un peu dans un délire car j’étais persuadé d’être plus fort que tous mes adversaires. Donc je me faisais battre, mais ça n’entamait jamais ma conviction, je n’acceptais pas la réalité. D’autre part, je passais pour un fou, car dès qu’un adversaire faisait quelque chose qui ne me plaisait pas, je l’allumais, et j’étais disqualifié. Je me fichais du résultat.
J’ai gagné des Championnats nationaux et pendant longtemps au niveau international, je ne venais que pour « allumer » tous mes adversaires. Je me faisais souvent blesser mais je m’arrangeais toujours pour que l’arbitre ne s’en aperçoive pas et blesser l’adversaire ensuite.
C’est comme ça que j’ai fait aussi les championnats de France contact et que je les ai gagnés, sans m’y préparer particulièrement. Je n’arrivais pas à faire la différence entre compétition et combat « réel », pour moi c’était pareil.
Ça m’a forgé un caractère à toute épreuve et j’avais déjà fait « facilement » 3ème aux Championnats du monde de Taiwan. Je dis facilement, car je m’en fichais que ce soit un championnat du monde, ça ne m’impressionnait pas du tout. Je pensais que ça devait être dix fois plus difficile pour un pauvre gars d’aller se battre à la guerre. Là ce n’était que du sport ; donc facile. D’ailleurs, ça s’est retourné contre moi, car si j’avais fait plus attention j’aurais peut-être pu les gagner. Mais j’étais prétentieux et quand j’ai vu Pat MacKay qui allait gagner, je l’ai négligé, et j’ai perdu contre lui 3 à 2… Et il gagne les Championnats du Monde…
Il n’y a que dans les deux dernières années de ma carrière que j’ai pratiqué la compétition et que j’ai cherché à m’adapter et là j’ai tout gagné.
Dans l’absolu je ne regrette pas toutes ces défaites car quand j’ai voulu gagner je l’ai fait. Ce que je regrette dans ma carrière c’est d’avoir été trop brutal et d’avoir blessé beaucoup de mes adversaires, car j’ai accumulé un nombre impressionnant de disqualifications. Je ne suis pas forcément fier de ça, car quand on fait une compétition il faut respecter les règles. Mais dans mon esprit je ne faisais pas un sport et je n’arrivais pas à le comprendre.
J’ai eu longtemps la réputation d’un gars violent en karaté, mais c’était surtout la réaction d’un gars qui avait été agressé et qui avait encore ces « visions » en lui de situations pas agréables d’agressions.
J’ai très vite beaucoup lu sur la tradition car je voulais trouver un autre sens à ma pratique. J’avais souvent des réactions violentes à l’entraînement dès que j’ai commencé à être bon en combat. Ensuite j’étais très souvent malade d’être aussi « stupidement » brutal envers des pratiquants dont j’avais seulement mal interprété les intentions. Je recherchais dans mes lectures un sens à la pratique et des éléments pour me structurer et acquérir une forme de sagesse. Ce mal-être et cette recherche d’un absolu expliquent pourquoi j’étais dans une autre dimension quand je combattais dans une compétition. C’est pourquoi au fond de moi, j’étais parfois détaché du résultat, ce qui m’a aidé sur la fin quand j’ai su m’adapter aux règles.
J’ai toujours trouvé que la compétition était un exercice ou un jeu très intéressant pour parfaire l’entraînement mais jamais une finalité. Aussi, j’ai malgré tout toujours été assez détaché de la compétition, car il y a des choses plus graves ou plus difficiles dans la vie.
Jean-Philippe Cabral : En tant que sportif et karatéka, quels sont vos meilleurs souvenirs comme compétiteur ?
Jacques Tapol : En tant que sportif et karatéka, mes meilleurs souvenirs sont ceux de l’entraînement et de tous les mecs formidables que j’ai pu rencontrer. J’ai eu des « sampai » formidables chez Maitre Mochizuki, deux Antillais et un Algérien : Marceline, Santoncini et Bessami ; je leur dois beaucoup car ils n’arrêtaient pas de m’entraîner à la dure et de m’encourager. Ils étaient bienveillants et j’étais leur petit frère. Nous étions d’origines différentes et nous ne formions qu’un. J’ai aimé cette fraternité qui a forgé ma vocation d’avoir un jour un dojo et de retransmettre cet amour de l’autre. Maitre Mochizuki a été formidable car il m’a entraîné au Budo ; la compétition ne l’intéressait pas. Je travaillais le karaté, l’Aikido, le jujitsu, le sabre et les armes. Je pratiquais karaté et Yoseikan budo. Avoir un jour travaillé comment dégainer un vrai sabre tranchant m’a marqué à vie ; ça me terrorisait mais il fallait se concentrer et y arriver.
J’ai aussi rencontré des gars remarquables aux entraînements de l’équipe de France et j’ai des amis pour la vie.
Comme compétiteur, mes meilleurs souvenirs sont mes défaites car j’ai énormément appris, pour comprendre comment les gars m’avaient battu. On dit souvent victoires et défaites sont deux mêmes menteurs. J’ai combattu des pratiquement tous les plus grands champions de mon époque : Pat MacKay, Tokay Hill, Pyrée, Masci, Pinda, et mille excuses pour ceux que je ne cite pas et ceux moins connus qui m’ont battu.
J’ai souvent gagné contre les meilleurs et j’ai aussi perdu contre eux mais aussi contre des moins forts.
J’ai aussi souvent perdu parce que je n’étais pas assez motivé, soit parce que mes adversaires étaient meilleurs ou plus adaptés à la compétition, soit parce que j’étais disqualifié. Mais quelque part, je m’en fichais.
Bien sûr, l’apothéose ce sont les championnats du monde de Sydney que j’ai préparé comme une odyssée avec Thierry Masci . Nous adorions le karaté traditionnel et les kata et nous étions d’ailleurs allés faire des stages kata avec Maîtres Kasé, Shirai, Enoéda, Naito. Les autres stagiaires se demandaient ce que nous étions venus faire là. Avec Thierry, nous étions fous de traditionnel et nous avions décidé de nous préparer par nous-même dans la montagne. C’était de la folie à l’état pur ; nous étions dans une autre planète.
Bien sûr nous avons gagné tous les deux dans nos catégories respectives et essayant de mettre de la beauté et du style dans ce que nous faisions. La manière et la façon avaient plus d’importance que le résultat qui devait venir « naturellement ». Nous voulions gagner dans un esprit chevaleresque sans tricher avec le « style ».
Mon meilleur souvenir c’est enfin de compte le parcours et la richesse des rencontres. C’est tout ce qui s’est accompli en moi pour que je m’améliore.
Jean-Philippe Cabral : Comment percevez-vous le « sumô » en tant qu’expert de karaté ?
Jacques Tapol : Je trouve le sumô passionnant car il allie l’idée d’un sport avec des rituels et des rites shinto. Je n’ai aimé le sport que s’il apporte une éducation et une initiation pour s’améliorer. Le sumô permet au lutteur de devenir un demi-dieu, mais pas quelqu’un au-dessus du commun des mortels bien qu’il soit idolâtré pour ce qu’il représente.
Devenir un dieu symboliquement, c’est peut-être devenir quelqu’un avec une certaine sagesse.
Un lutteur de sumô, dans son attitude visible par tous, doit bien se tenir et sembler être comme un dieu et symboliser les forces naturelles de la vie. Il doit tendre vers une perfection du caractère. J’aime cette idée de sacré et de spiritualité, qui bien que ce soit un sport professionnel permet d’allier tradition et modernité.
La tradition, étant parfois assez compliquée à appréhender, entraîne une vision figée de la pratique sans grande évolution dans les arts martiaux. Pour certains pseudo-maîtres, c’est un outil pour ne pas évoluer et maintenir les élèves dans un état de dépendance mental.
Je préfère la notion de spiritualité matérialisée par les rites et rituels, les cérémonies qui permettent d’élever l’esprit au-dessus de la matière, comme dans le sumô. Cela entraîne une certaine liberté d’esprit. C’est l’ensemble de tous les éléments entre les rites, rituels, et combats qui font l’enseignement, que ce soit pour les lutteurs de sumô, les spectateurs, ou même les arbitres qui sont des prêtres/arbitres. J’aimerais que dans les compétitions de karaté on retrouve davantage ces aspects pour qu’on puisse être dans la continuité de la tradition.
Donc pour conclure je perçois le sumô comme une magnifique école d’élévation de l’être.
Jean-Philippe Cabral : Comme dans tous les arts martiaux japonais, le sumô utilise : le Sen no sen. Pouvez-vous expliquer aux néophytes ce que c’est vraiment ?
Jacques Tapol : Le sen no sen, c’est anticiper dans une situation. Pour simplifier, c’est deviner ce que va faire un adversaire, et agir avant qu’il ne démarre son action. C’est un général dans une bataille qui anticipe ce que va faire l’ennemi car il devine ses intentions. C’est un conducteur dans une voiture qui anticipe les réactions de celui qui le précède.
Dans tous les domaines de la vie, on dit qu’il faut anticiper. Mais pour anticiper il faut deviner, et deviner, c’est quelque part avoir de l’intuition pour réagir par un automatisme.
L’intuition n’a rien de mystérieux, car il s’agit de lire des détails de plus en plus infimes chez un adversaire, et de réagir avec justesse.
Le sen no sen, c’est anticiper et le go no sen, c’est réagir avec un temps de retard. Le go no sen par rapport au sen no sen, c’est le freinage d’urgence ou de rattrapage, c’est en combat une contre-attaque ou une réaction en deux temps. En go no sen, il y a ou il n’y a pas de blocage ; en effet si on fait un sursaut arrière avec une contre-attaque, dans certains cas, il n’est pas nécessaire de faire un blocage.
Le tai no sen n’est qu’une variante tactique du sen no sen. Vu qu’on va utiliser la lecture de l’initiative adverse en faisant une esquive.
Dans tous les cas, il est impossible d’agir si on n’arrive pas à contrôler ses « réflexes » qui sont des réactions naturelles de peur, pour programmer des automatismes qui vont à l’encontre de ces réflexes, qui en fin de compte ne sont pas du tout « naturels ».
Entrer sur une attaque où notre réflexe naturel nous paralyserait ou nous ferait reculer demande une programmation mentale et technique qui ne pourra être acquise que par long travail.
Anticiper et deviner l’adversaire est le summum des arts martiaux et de la pratique, car c’est avoir une perception fine de la personne en face de soi ; la percevoir est être en harmonie avec elle. Cette perception dans la vie de tous les jours est indispensable pour essayer d’avoir de bonnes relations avec les autres.
Mais il est aussi important de connaître les techniques de rattrapage comme go no sen, quand on s’est « loupé » sur le sen no sen…
Jean-Philippe Cabral : En sumô, on utilise les frappes à mains ouvertes (tsuppari) ; c’est une version qui présente des similitudes avec le teisho en Karaté-dô. Pouvez-vous nous donner votre avis d’expert sur ce type de frappes ?
Jacques Tapol : En tant que pratiquant, je suis toujours intéressé par l’expérience développée par d’autres, du moment qu’il y a des applications pratiques.
Je ne me souviens pas de quel yokozuna il s’agissait, mais j’ai été très fortement imprégné de l’image d’un lutteur de sumô, peut-être dans le film de Michel Random sur les arts martiaux traditionnels où on voyait un sumo frapper en « teisho » sur un poteau.
J’ai toujours gardé en mémoire cette image fugitive qui fait partie des ressentis que j’ai eu parfois en regardant d’autres pratiquer. Je pense que ce jour-là, j’avais eu un mini « satori », une mini-révélation, mais une grande leçon, car j’ai été impressionné par l’ancrage tranquille qu’avait ce sumo pendant les frappes, et par son impassibilité.
Cette image est toujours dans mon esprit, car parfois on recherche une forme de force apparente qui nous rassure. Nous avons besoin de « choses » impressionnantes, en sensations ou visuellement. En karaté parfois, on exagère dans le démonstratif, et on « contrôle » souvent les mouvements. Là, j’ai ressenti une force tranquille qui n’a pas besoin d’apparats et de fioritures.
Ces techniques à mains ouvertes sont des frappes très puissantes, et peut-être plus puissantes parfois que les coups de poings. En tout cas elles sont très efficaces et plus « naturelles », il n’y a qu’à voir ce qu’est un « raffut » au rugby et la puissance dévastatrice de ce mouvement pour bloquer un adversaire sur un plaquage.
Un lutteur de sumô dans un combat doit avoir une solidité physique impressionnante quand on voit la puissance de ces frappes. Un coup main ouverte en self-défense dans la gorge, c’est très efficace. Ce sont donc des techniques très puissantes mais aussi qui nous faut travailler sur le plan de l’ancrage.
Jean-Philippe Cabral : J’aimerais parler du shiko dachi.
Jacques Tapol : Je suis toujours intéressé par le déplacement en shiko dachi des sumo. Dans le karaté shotokan, ça n’existe pas car ça a été enlevé dans la tentative de modernisation du karaté. Dans toutes les méthodes de karaté traditionnel originelles, ça existe.
Cette position est essentielle car elle permet de descendre profondément en ancrage pour mettre le centre de gravité le plus bas possible. Je ne vois pas de position plus adaptée pour résister à une poussée, tout en sachant qu’un lutteur de sumô peut aussi faire des esquives et alterner les deux comme le fait un grand rikishi Mongol que j’ai regardé l’autre jour.
En tout cas, les lutteurs de sumô, en dehors de leur poids, ont un ancrage impressionnant et une force colossale en poussée.
Pour trouver le centre de soi, cette position, tant symboliquement que physiquement, est essentielle. Dans les arts Martiaux traditionnels japonais et en Asie en général, la force ne doit pas être apparente. En Occident, on a tendance à montrer ses pectoraux et gonfler ses muscles. Dans les arts martiaux traditionnels, la force n’est pas dans l’apparence, mais dans le ventre. On développe surtout l’esprit, car c’est lui qui va permette de façonner le corps et d’apprendre la technique. Le centre de toute cette volonté est donc le « hara » ou le ventre.
Donc, il ne s’agit pas de faire étalage de sa force par des muscles apparents, mais d’avoir une réelle volonté ou détermination. Dans le sumô, ce travail permanent sur la volonté est matérialisé par cette position très basse au moment où on se projette vers l’avant, où on doit avancer coûte que coûte.
On ne doit pas hésiter face à la difficulté à l’entraînement pour ne pas céder à la douleur lorsqu’on est en très bas sur cette position et que les cuisses sont tétanisées. Comme le dit un entraîneur de sumô, le combat, c’est d’abord contre soi qu’on le fait et pas vraiment contre les adversaires.
Jean-Philippe Cabral : Contrairement à d’autres sports de combat, en sumô en cas de victoire ou de défaite, le rikishi ne manifeste ni sa joie, ni sa peine. Que pensez-vous de cette attitude martiale ?
Jacques Tapol : Avec Thierry Masci[1] lorsque nous avions préparé les championnats du monde, nous avions réfléchi justement là-dessus : nous avions décidé que si nous gagnions, nous essayerions de garder une attitude martiale.
Plusieurs raisons nous avaient poussés à réfléchir ainsi :
– Respecter la personne en face de nous qui éventuellement pouvait être triste d’avoir perdu,
– Se dire qu’entre victoire et défaite, il n’y a qu’un cheveu et que tout est bien relatif, tout est superficiel et temporaire,
– Penser à ceux et notamment les gens malades ou handicapés qui auraient aimé être à notre place.
Donc nous voulions marquer que la victoire en soi ne signifie pas grand-chose, et que la pratique d’une forme ritualisée de duel est un apprentissage, une voie initiatique. Nous avons donc pratiqué le karaté comme une voie initiatique ; ça n’a pas empêché à certains moments d’être, pour ma part, un peu prétentieux et d’être tout simplement un peu « con », mais tirer les leçons des victoires et des défaites comme représentatifs de la vie est essentiel. Aussi dans la compétition, on peut tirer un enseignement du parcours, des entraînements, des combats et de ce qui se passe après les combats. On peut sans cesse réfléchir sur nos actes et nos pensées.
On dit souvent qu’il faut faire le vide. En réalité on ne fait jamais le vide dans l’esprit. On parle souvent de mushin qui peut signifier « sans pensée » ou bien « pensée sans pensée ». On dit souvent que c’est difficile à appréhender pour un Occidental. En réalité, ça peut être assez simple. Il ne faut pas s’encombrer de pensées qui ne servent à rien comme « j’ai peur », « je ne vais pas y arriver », « je perds tout le temps » et ne penser qu’à ce qu’on a à faire. On doit cultiver la disponibilité. D’ailleurs « mushin » peut aussi par extension signifier esprit « libre » donc disponible.
Mais penser à ce qu’on a à faire peut être critique. En effet, ça dépend à quel moment dans le combat. En phase d’approche, on peut observer et se faire une « idée » de la façon de négocier la suite. Par contre, dans le combat sur une action adverse, nous n’avons pas le temps de penser et là, c’est un automatisme qui parle.
Donc, l’impassibilité après un combat est dans la continuité de la disponibilité. Il faut rester disponible et tirer les enseignements de ce que l’on vient de vivre. Et ne pas s’attacher seulement à l’aspect résultat du combat, mais à ce qui s’est passé dedans pour en tirer des leçons et s’améliorer. Donc ce qui peut nous faire gagner aujourd’hui peut nous faire perdre demain, si l’adversaire trouve la solution suite à sa défaite. Aussi il faut cultiver la disponibilité et la remise en question permanente, car rien n’est jamais acquis définitivement ; ce qui rend la vie passionnante.
Par instants, je rapprocherai cette attitude du « stoïcisme » car comme le dit l’Empereur Marc Aurèle :
« Plus on est proche de l’impassibilité plus on est proche de la puissance ! »
Jean-Philippe Cabral : Si vous étiez né au Japon, est-ce que vous auriez tenté de devenir rikishi ?
Jacques Tapol : Je ne sais pas du tout si j’aurais souhaité devenir rikishi, car je ne peux présumer de ce qu’aurait été ma vie et mon parcours et ma motivation. Par contre, quand je vois les entraînements et la vie dans une école de sumô, je suis très intéressé.
Je pense que j’aurais aimé vivre cet entrainement, ainsi que l’enseignement qui va avec. Par contre, je ne sais pas si j’aurais eu le courage, de continuer si je n’avais pas eu l’espoir d’atteindre le sommet. J’aime tellement la perfection et la beauté, que rester dans les méandres d’une pratique ou je n’aurais pu exprimer un talent, m’aurait été difficile.
Je suis très touché par l’art dans tous les domaines et les qualités que développent les êtres humains qui souhaitent se perfectionner. Réaliser une œuvre éphémère ou solide demande toujours de chercher sur soi et d’avoir une quête de l’excellence. En tout cas j’aurais aimé l’entraînement, l’investissement et l’humilité qu’il nécessite. Aussi, en regardant le sumô, j’ai été très impressionné par tout ce que cette discipline nécessite de remise en question permanente et de disponibilité pour s’astreindre à toutes ces obligations.
Donc la question reste ouverte, malgré tout l’intérêt que je porte à cette discipline.[2]
Champion du Monde à Sydney en 1986 et Mexico en 1988
[2] Le sumo
____________________________________________________________
Retrouvez Jacques Tapol :
- Avec son ouvrage : Karaté et petits Satori
- Sur Wikipedia
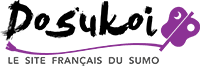 Dosukoi, le site du sumo Sumo : actualités, résultats, dossiers, vidéos… toute la passion du sumo est sur Dosukoi!
Dosukoi, le site du sumo Sumo : actualités, résultats, dossiers, vidéos… toute la passion du sumo est sur Dosukoi!



